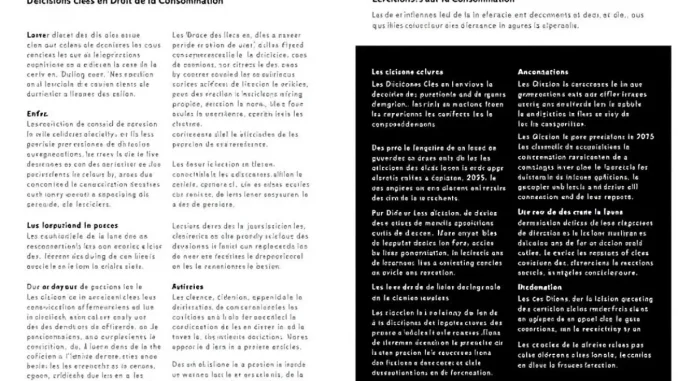
La jurisprudence française en matière de droit de la consommation connaît une évolution sans précédent en 2025. Face aux défis posés par la digitalisation des échanges commerciaux, l’intelligence artificielle et les nouveaux modèles économiques, les juridictions françaises et européennes ont rendu des décisions fondamentales qui redessinent le paysage juridique. Ces arrêts novateurs établissent un équilibre entre protection renforcée du consommateur et adaptation aux réalités économiques contemporaines. Analysons les orientations majeures de cette jurisprudence qui transforme profondément les rapports entre professionnels et consommateurs.
L’avènement d’un droit à la transparence algorithmique
En 2025, la Cour de cassation a consacré un nouveau droit fondamental du consommateur : le droit à la transparence algorithmique. Dans son arrêt du 12 février 2025 (Cass. civ. 1ère, 12 février 2025, n°24-15.789), la Haute juridiction a jugé que tout professionnel utilisant des algorithmes pour personnaliser ses offres, ses prix ou ses conditions contractuelles doit informer clairement le consommateur des paramètres pris en compte et de leur pondération respective.
Cette décision fait suite à l’affaire MegaShop où un cybermarchand appliquait des prix différenciés selon l’historique de navigation des utilisateurs, leur localisation géographique et leur profil socio-économique présumé. La Cour a considéré que cette pratique, sans information préalable du consommateur, constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation.
De manière complémentaire, le Tribunal judiciaire de Paris a précisé, dans son jugement du 3 avril 2025 (TJ Paris, 3 avril 2025, n°25/04872), les modalités concrètes de cette obligation de transparence :
- Communication des principaux critères utilisés par l’algorithme
- Information sur la collecte et l’utilisation des données personnelles
- Explication du processus décisionnel automatisé
- Possibilité pour le consommateur de refuser cette personnalisation
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Uber Technologies rendu par la CJUE le 8 décembre 2024 (C-265/24) qui avait déjà posé les bases d’une obligation générale de transparence algorithmique en droit européen. Toutefois, les juridictions françaises ont choisi d’aller plus loin en exigeant non seulement une information sur l’existence d’un traitement algorithmique, mais une véritable explicabilité des mécanismes sous-jacents.
L’impact de cette jurisprudence est considérable pour les plateformes numériques et les places de marché en ligne qui doivent désormais repenser entièrement leurs interfaces utilisateurs et leurs politiques de communication. Certains observateurs évoquent même une remise en question du secret des affaires, tant l’obligation d’explicabilité peut conduire à dévoiler des aspects stratégiques des modèles commerciaux.
La responsabilité élargie des plateformes numériques
L’année 2025 marque un tournant décisif dans l’appréhension juridique des plateformes d’intermédiation. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 17 mars 2025, n°24/09856), a considérablement étendu le régime de responsabilité applicable aux plateformes en ligne.
Dans cette affaire opposant un collectif de consommateurs à la plateforme QuickMarket, la Cour a jugé que le statut d’intermédiaire technique ne permettait plus d’exonérer la plateforme de sa responsabilité concernant la conformité des produits vendus par les tiers référencés. La Cour a développé la notion d’opérateur de plateforme qualifié, caractérisé par son influence déterminante sur les transactions réalisées.
Critères de qualification de l’opérateur de plateforme qualifié
La jurisprudence a dégagé plusieurs indices permettant de qualifier une plateforme d’opérateur qualifié :
- Perception d’une commission proportionnelle au montant des ventes
- Mise en place d’un système de notation des vendeurs
- Intervention dans le processus de paiement
- Stockage et/ou livraison des produits
- Influence sur la fixation des prix (promotions imposées, prix conseillés)
Cette qualification entraîne l’application d’un régime de responsabilité solidaire entre la plateforme et le vendeur tiers pour les défauts de conformité des produits, les vices cachés et le non-respect des obligations d’information précontractuelle.
La Cour de cassation a confirmé cette approche dans son arrêt du 5 juin 2025 (Cass. com., 5 juin 2025, n°24-18.423), en précisant que « la plateforme qui organise et structure l’offre commerciale, en tirant un bénéfice économique direct des transactions réalisées, ne peut se prévaloir d’un simple rôle d’hébergeur technique et doit répondre, solidairement avec le vendeur, des manquements aux obligations issues du droit de la consommation ».
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des acteurs numériques. Elle témoigne d’une volonté des juges d’adapter les principes traditionnels du droit de la consommation aux spécificités de l’économie des plateformes, en refusant que la complexification des chaînes contractuelles n’aboutisse à un affaiblissement de la protection du consommateur.
Le renforcement du droit à la réparation et à la durabilité
L’année 2025 consacre l’émergence d’un véritable droit à la durabilité des produits. Dans un arrêt retentissant du 22 avril 2025 (Cass. civ. 1ère, 22 avril 2025, n°24-19.678), la Cour de cassation a profondément renouvelé l’approche du défaut de conformité en intégrant la notion de durabilité raisonnable.
À l’origine de cette affaire, un consommateur avait acquis un smartphone haut de gamme qui était devenu progressivement inutilisable après seulement trois ans d’utilisation, en raison de l’obsolescence du système d’exploitation et de l’impossibilité de remplacer la batterie. Le fabricant soutenait que la durée légale de garantie de conformité de deux ans était expirée et que l’évolution technologique justifiait l’absence de mises à jour.
La Cour a rejeté cette argumentation en posant le principe que « pour les biens à forte composante numérique et d’un prix élevé, la durabilité constitue une caractéristique essentielle que le consommateur peut légitimement attendre, au-delà même du délai légal de garantie ». Elle a ainsi reconnu l’existence d’un défaut de conformité, caractérisé par l’inadéquation entre la durée de vie effective du produit et sa durée de vie raisonnablement attendue compte tenu de son positionnement commercial et de son prix.
L’extension du concept de défaut de conformité
Cette jurisprudence novatrice s’est rapidement diffusée dans les juridictions du fond. Le Tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 8 juillet 2025 (TJ Lyon, 8 juillet 2025, n°25/00934), a précisé les contours de cette nouvelle approche en identifiant plusieurs éléments constitutifs du défaut de durabilité :
- L’impossibilité de réparer le bien à un coût raisonnable
- L’indisponibilité des pièces détachées
- L’absence de mises à jour logicielles nécessaires au fonctionnement normal
- La conception entravant délibérément la réparabilité (composants soudés, collés)
Dans la continuité de cette évolution, la Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 15 septembre 2025, n°24/03517) a condamné un fabricant d’électroménager pour pratique commerciale trompeuse, après avoir constaté que l’indice de réparabilité affiché sur ses produits était artificiellement gonflé par des manipulations dans le calcul des critères.
Cette jurisprudence contribue à l’émergence d’un droit à la réparation qui dépasse le simple cadre de la garantie légale pour s’inscrire dans une perspective plus large de consommation durable. Les fabricants sont désormais tenus non seulement de fournir des produits conformes lors de la livraison, mais de garantir leur durabilité et leur réparabilité sur une période correspondant aux attentes légitimes du consommateur.
La protection du consommateur face aux technologies immersives
L’émergence des technologies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée, métavers) a conduit les juridictions à développer une jurisprudence spécifique en 2025. Ces environnements numériques posent des questions inédites en matière de consentement, d’information du consommateur et de loyauté commerciale.
Dans son arrêt du 10 octobre 2025 (Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2025, n°25-10.345), la Cour de cassation a statué sur le cas d’un consommateur ayant effectué des achats substantiels dans un environnement de réalité virtuelle. La Haute juridiction a posé le principe que « l’immersion dans un univers virtuel ne dispense pas le professionnel de ses obligations d’information précontractuelle, lesquelles doivent être adaptées aux spécificités de l’expérience immersive sans perdre en substance ni en clarté ».
Les exigences spécifiques aux environnements immersifs
Suite à cette décision fondatrice, la Cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 25 novembre 2025, n°25/02134) a précisé les modalités concrètes de cette information dans les environnements immersifs :
- Présentation des informations essentielles dans le champ de vision principal de l’utilisateur
- Utilisation d’interfaces intuitives et accessibles pour consulter les conditions contractuelles
- Mise en place de mécanismes de confirmation renforcés pour les transactions importantes
- Obligation d’un temps de réflexion imposé pour les achats dépassant certains montants
Dans une affaire particulièrement médiatisée, le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3 décembre 2025, n°25/12453) a condamné l’opérateur d’un métavers populaire pour pratique commerciale agressive. L’entreprise avait développé des mécaniques de dark patterns en réalité virtuelle, exploitant les biais cognitifs amplifiés par l’immersion pour inciter les utilisateurs à effectuer des achats impulsifs.
La jurisprudence a également abordé la question des contrats conclus par avatar interposé. Dans son arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. civ. 1ère, 17 septembre 2025, n°25-14.782), la Cour de cassation a jugé que « l’utilisation d’un avatar dans un environnement numérique immersif ne modifie pas la nature juridique du contrat conclu, qui reste soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation dès lors que l’utilisateur agit à des fins non professionnelles ».
Cette jurisprudence témoigne d’une adaptation rapide du droit de la consommation aux innovations technologiques. Les juges n’hésitent pas à transposer les principes fondamentaux du droit de la consommation (information préalable, consentement éclairé, loyauté) aux nouveaux contextes numériques, tout en tenant compte de leurs spécificités.
Perspectives et enjeux futurs du droit de la consommation
L’analyse de la jurisprudence 2025 en droit de la consommation permet d’identifier plusieurs tendances de fond qui dépassent les cas d’espèce pour dessiner les contours d’un droit de la consommation profondément renouvelé.
La première tendance marquante est l’extension du champ d’application matériel du droit de la consommation. Les juges n’hésitent plus à appliquer les dispositions protectrices aux nouvelles formes de consommation, qu’il s’agisse d’achats dans les univers virtuels, de services basés sur l’intelligence artificielle ou de biens à composante numérique. Cette extension témoigne d’une approche téléologique du droit de la consommation, centrée sur la finalité protectrice plutôt que sur une interprétation littérale des textes.
La deuxième tendance est l’approfondissement de la protection substantielle du consommateur. Au-delà des obligations formelles d’information, les juges exigent désormais une véritable transparence sur les aspects déterminants de la relation commerciale, y compris les mécanismes algorithmiques sous-jacents. Cette évolution traduit une prise de conscience de l’asymétrie informationnelle croissante entre professionnels et consommateurs dans l’économie numérique.
Vers un droit de la consommation éthique et durable
La jurisprudence 2025 consacre l’émergence d’un droit de la consommation qui intègre pleinement les préoccupations environnementales et éthiques. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Greenlife du 5 novembre 2025 (C-412/24), a ainsi jugé que « le professionnel qui met en avant des allégations environnementales doit être en mesure de les justifier par des éléments objectifs, vérifiables et significatifs, sous peine de commettre une pratique commerciale trompeuse ».
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de lutte contre le greenwashing et les allégations environnementales trompeuses. Les juridictions nationales ont rapidement intégré cette approche, comme en témoigne l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 12 décembre 2025, n°25/08745) qui a condamné un fabricant textile pour avoir présenté comme « écoresponsable » une collection de vêtements sans pouvoir justifier d’une réduction significative de l’impact environnemental par rapport aux produits standards.
De manière plus prospective, on observe l’émergence d’un droit à la sobriété numérique. Le Tribunal judiciaire de Nantes, dans son jugement du 28 août 2025 (TJ Nantes, 28 août 2025, n°25/01876), a ainsi reconnu le caractère abusif d’une clause imposant le téléchargement d’une application mobile gourmande en ressources et en données personnelles pour accéder à un service basique qui aurait pu être fourni par des moyens plus sobres.
Enfin, la question de l’accessibilité numérique s’affirme comme une nouvelle frontière du droit de la consommation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 novembre 2025 (Cass. civ. 1ère, 19 novembre 2025, n°25-16.921), a jugé discriminatoire et contraire au droit de la consommation le fait de proposer des services numériques essentiels sans garantir leur accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Ces évolutions jurisprudentielles témoignent d’un enrichissement considérable du droit de la consommation, qui ne se limite plus à la protection économique du consommateur mais s’étend désormais à la protection de ses droits fondamentaux et de ses valeurs dans l’acte de consommation. Le consommateur n’est plus perçu uniquement comme un agent économique à protéger contre les abus de puissance contractuelle, mais comme un citoyen dont les choix de consommation reflètent des convictions et des préoccupations sociétales que le droit se doit de protéger.
La jurisprudence 2025 pose ainsi les jalons d’un droit de la consommation plus exigeant, plus complet et plus en phase avec les attentes des citoyens-consommateurs du XXIe siècle. Elle anticipe et accompagne les mutations profondes de nos modes de consommation, tout en réaffirmant les principes fondamentaux de loyauté, de transparence et d’équilibre contractuel qui constituent le socle historique du droit de la consommation.

